Le passage indépendance fut désigné en Algérie comme une rupture absolue. Celle-ci fut moins absolue qu’on le dit, comme c’est la règle.
Après une première explosion, où cent fleurs épanouirent dans la plus parfaite anarchie, on allait s’attacher plus encore que par le passé, à régenter le domaine de art. La fondation en 1963, d’une Union nationale des Arts plastiques (UNAP) était le fait d’une escouade de très libres et très authentiques créateurs. Mais après que l’on eût décidé d’étendre à l’UNAP le règlement stipulant que les postes de responsabilité devaient être tenus par des membres du FLN, les artistes professionnels reconnus furent rapidement écartés pour être remplacés par des artistes entièrement subordonnés au politique.
Il s’agissait alors particulièrement de donner une illustration nouvelle à la société en formation. Elle prit une forme convenue, celle d’un art martial évoquant de façon mythique les récits héroïques de la guerre indépendance. Des panneaux fleurirent sur toutes sortes de supports, pour illustrer les slogans de la révolution (1).
L’ homme de cette prise en main le plus “artiste” de tous sans doute, fut Boukhatem Fares. Blessé à seize ans alors qu’il franchissait la ligne Morice, il se met croquer en autodidacte, la lutte des maquis. Franz Fanon qui le visite à l’hôpital Sadiki l’encourage. Il passera la guerre en Tunisie avec l’armée des frontières. Il a quelque titre a revendiquer un art militant, lié au peuple et son combat révolutionnaire. Il deviendra, à partir de 1973 et pour dix années (1973-1984) le tout-puissant secrétaire général de UNAP au détriment des fondateurs jugés artistes “bourgeois”, trop liés aux traditions artistiques de l’Occident. De la sorte, au nom de sa liaison organique avec l’armée en guerre, il s’institua peintre officiel d’un régime (2).
Prônant un métier acquis sur le tas et en contact avec les réalités de histoire, il promeut de laborieux fabriquants de “fresques” (3), célébrant à la commande, sur les lieux des combats, les moments de gloire d’une guerre héroïque. L’Algérien prend alors la figure du soldat au geste fier et triomphant avec casquettes et patogas verts, uniformes rutilants et armes de guerre. Sous la convention maoïste – il a étudié à Pékin – qui dominait alors, on retrouve la gestuelle de l’art fasciste et, plus troublant le pas martial des bas-reliefs célébrant la patrie à l’époque coloniale.
Appliqués sur des supports précaires et en plein air, ces images qui devaient littéralement couvrir Algérie disparurent aussi vite que les slogans qui les portaient. Il en resta pas trace une fois émotion retombée sinon sous une forme paradoxalement miniaturisée dans les timbres postes soigneusement archivés, ceux-là, par obsession philatélique.
Dans cette phase révolutionnaire deux peintres authentiques se trouvent notamment impliqués : M’hemed Issiakhem et Mohamed Khadda. Nés tous deux dans les années trente, formés dans le Paris des années cinquante où triomphait abstraction lyrique, ils exercèrent un et autre un ascendant considérable sur la génération de indépendance.
Leur contribution à art monumental est ici fort différente. Peintre engagé et tragique, Issiakhem devait donner un visage la douleur de l’Algérie moderne. Mais une tendance anarchiste marquée le conduisit à subvertir l’engagement. Il réalisa cependant une fresque. Ce fut pour décorer une salle de la “maison des syndicats” – autrement dit le Foyer civique, dont nous avons parlé plus haut selon la nouvelle destination donnée au local après indépendance. Cette oeuvre, dont ses amis disent qu’elle ne rajoutait rien sa gloire, connut le sort malheureux des entreprises de cet ordre : elle fut tout simplement recouverte une couche de badigeon. Une étrange malédiction continuait de frapper les oeuvres abritées par ce bâtiment surdimensionné.
Homme de culture et de réflexion, Khadda s”attacha à intervenir sur la place publique par conviction politique. Lié au parti communiste dès avant la guerre de libération, il partage la conviction de tant intellectuels de ce temps que art doit aller en ler vers le peuple, et que les créateurs doivent participer aux grands mouvements de histoire. Mais, disciple d’Aragon et de Picasso, il n’est pas prêt à abjurer sur la question de la modernité, ou à faire des concessions à un quelconque réalisme socialiste : “Cette forme d’expression qui singe et contrefait le discours officiel dominant et qui aboutit, en fait desservir et art et la politique” (Khadda 1983 : 51)
Pourtant, c’est en référence la grande peinture murale mexicaine il lançait une proclamation qui fit date :
“Sans condamner pour autant la peinture de chevalet, nous pensons que oeuvre d’art doit se tenir dans la rue, sur les places publiques, doit tapisser les façades des édifices, éclairer les murs aveugles ; l’art pictural retrouvera ainsi son ampleur et son sens” (ibid 15).
Hic Rhodos hic salta ! (4) On était au temps de la révolution agraire Sur le modèle de la révolution culturelle chinoise, une sincère ardeur militante portait la jeune classe intellectuelle aller vers le peuple et, singulièrement, vers les paysans. A l’occasion d’un séminaire culturel tenu à Saïda, ville de intérieur, en avril 1973, des artistes décident de se rendre au village socialiste de Ma’amûra pour réaliser une oeuvre collective (5). Khadda s’alliait à trois autres peintres. Parmi eux, Denis Martinez responsable d’un atelier à l’école des Beaux-Arts.
Sur un panneau de contre-plaqué de 420 x 170m, ils réalisent, difficilement ensemble, en six heures, une oeuvre parfaitement abstraite, qui rompt avec les conventions propres du réalisme militant alors en vogue. Le soir, les villageois se rassemblent devant oeuvre météorite :
“Les volontaires et paysans, revenus des champs, entouraient notre petit chantier. Le cercle se fit et, tout naturellement, la halqa (cercle à se constitua. Car était la coutume (…). Et jamais ces habitants des hauts plateaux, habituellement avares de paroles et parfois méfiants, n’ont tant parlé, ni tant questionné” (ibid : 99-100).
En clair, les responsables locaux, intellectuels organiques de service, s’attendaient un autre type de peinture : où sont les soldats en uniformes ? et les drapeaux algériens ? Mais Khadda et ses amis revendiquent une authenticité plus fondamentale. L’abstraction est pas un art bourgeois, un produit de la dégénérescence de Occident ! Elle puise au plus profond, au plus essentiel dans la civilisation des Arabes. Elle est sur les tapis et les poteries primitives, productions locales de artisanat. Et de se revendiquer de “école du signe” où le schéma abstrait de lettres arabes va porter la structure du tableau. Même s’il y a quelque rhétorique défensive dans ce propos, on ne saurait en récuser de front la pertinence.
On ne peut dire pourtant que cette tentative, déjà fort isolée, d’associer art moderne et révolution socialiste ait eu un réel impact. La tentative globalement, va se voir son tour contrée par une opération d’édition, forme d’art industriel s’il en est. Celle-ci était menée par un puissant ministre de la Culture, Taleb-Ibrahimi, qui appelait un retour à un réalisme plus tempéré, et cela par la promotion de deux peintres Mohammed Racim, dont il été question, et Etienne Dinet, peintre d’époque coloniale mort en 1930, mais sanctifié grâce à sa conversion à l’islam (6). Ce sont ceux-là qui pour quelque temps devaient donner une image légitime de homme algérien Antinomie réelle dont Khadda devait se souvenir au moment de la mort tragique de Racim : Cette image de Algérie qui était bien aux antipodes des déchirements de l’Algérie coloniale; l’était plus encore des douloureuses recherches sociologiques de la nouvelle république algérienne.
François Pouillon
Source : Cahiers d’Études africaines / Année 1996
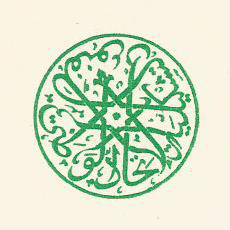
logo de l’UNAP
Note :
1- Lorsque architecte Fernand PouiUon chercha rehausser d’une vaste céramique le grand porche de ensemble Diar es-Saâda construit sur les hauts de la ville; il commanda à Andrée Autran une composition sur le thème de la marine…
2- Placés sur des supports fragiles, ils ne furent exceptionnellement conservés. Un témoignage tardif dans LAIB (1980)
3- Cf. de nombreux articles de presse et Fares. 1989
4- C’est ainsi que on appelle aujourd’hui en Algérie, indifféremment du support, toutes les peintures monumentales.
5- “Voici Rhodes, c’est ici il faut sauter”. Proverbe latin inspiré une fable d’Ésope qui signifie : c’est le moment de montrer ce dont tu es capable”. Note à l’édition française du 18 Brumaire de Karl MARX (1976 20), où figure cette sentence.
6- Cf. “Une fresque dans un village socialiste Maamoura in KHADDA” (1983 : 97-101) ; ainsi que Journal de bord une fresque (ibid 87-91).
7- Nous avons analysé ailleurs les conditions de cette réappropriation PODILLON (1990).






